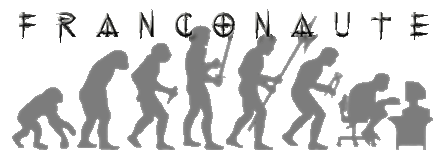
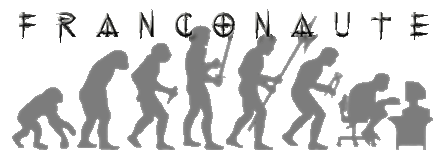 |
Quelle frontière idéale pour l'empire romain?
Je me demande si la conquête de la gaule ne fut pas une erreur.
Si les romains s'étaient contentés de la provence, s'ils s'étaient bornés à faire de la méditerranée un lac romain, ils auraient peut-être eu moins d'ennemis. Les envahisseurs germano-huns poussaient vers le soleil couchant. Sans la gaule, les romains ne se seraient pas pris tous ces peuples sur le râble. La gaule aurait encaissé ces invasions comme elle aurait pu et les envahisseurs n'auraient pas tous poussé vers le sud. Avec un empire plus petit, Rome aurait eu moins d'ennemis et aurait moins eu besoin de diviser ses armées. Je me demande si Rome ne souffrait pas de surexpansion stratégique... Bien entendu si je doute de l'intérêt de conquérir la Gaule, j'ai encore plus de doutes concernant l'intérêt de conquérir la Bretagne. A quelle vitesse se déplaçaient les armées romaines sur mer? Sur terre elles parcourraient jusqu'à 40 km par jour. |
Citation:
Concernant les frontières ... mais l'empire n'a pas de fin, voyons (copyrigth Coelio ... :chicos: ). Sinon il y a toujours cette thèse récurrente sur la conquête inachevé de la Roumanie (Trajan puis Marc Aurèle). Le contrôle des Carpathes (et de ses cols) auraient permis à l'infanterie romaine de bloquer la cavalerie des peuples nomades :confus: Mais il faudrait demandé à Coelio. Voili, voilou |
Dès le temps de Jules César les Germains commençaient déjà à franchir le Rhin. Celà lui a d'ailleurs pas mal servi à justifier son intervention auprès des Gaulois. Sans Jules César je pense qu'il n'aurait pas fallut attendre beaucoup avant de voir une Gaule entièrement envahie. Du coup l'Espagne, la Gaule Transalpine et l'Italie se seraient trouvées menacées bien plus tôt.
La Gaule est vite devenue l'une des régions les plus dynamiques et les plus riches de l'Empire sous la Pax Romana. Je pense au contraire que les Empereurs auraient du continuer la conquête de la Germanie et s'établir sur le Danube comme ils ont un temps tenté de le faire. Bref établir un buffer géant entre le poumon de l'Empire d'Occident et les peuples nomades. De plus Rome avait besoin de toujours plus de conquêtes. Depuis longtemps La Ville ne constituait plus un atout mais une charge. L'armée était recrutée en Gaule Cisalpine. La plèbe romaine désœuvrée représentait plutôt des bouches à nourrir et une menace insurrectionnelle constante pour la République. D'où la nécessité de l'abreuver constamment de victoires et de butin. Donc selon moi la survie de l'Empire passaient par une posture offensive permanente. Un peu comme pour l'Empire Ottoman. |
L'Elbe ou le Danube?
|
La gaule n'a pas representé de veritable problème pour l'empire romain, cela a plutot augmenté leur possibilité de defenses grace à l'integration de la population dans l'empire, qui augmenta le nombre de troupe recrutable.
Lors des invasions barbare, on peut voir que les peuples germains ne se sont pas contenté d'entrer en gaule, ils se sont tous repouser de plus en plus loin au seins de l'empire, s'installant partout sur la partie occidental de celui-ci. La chute relève plus des luttes intestine pour le pouvoir, qui a enlever tout cohésion a l'empire, empechant toute lutte efficace contre les barbares sur le long terme. |
Le rêve déçu d'Auguste c'était de conquérir la Germanie entre le Rhin et le Danube.
|
Bubu je pense que tu veux parler du fleuve Elbe plutot, le danube étant deja leur frontière dans les balkans, avec le petit morceau de roumanie avec.
|
Il me semble pourtant me souvenir que toute la Germanie était concernée et donc également la partie au nord du Danube:
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_g...rconstance.asp |
Ce texte parle de l'Elbe. Si la frontière est portée sur l'Oder, les romains se retrouveraient en contact avec les scandinaves.
|
Le Danube ne touche pas la Scandinavie et je ne crois pas que les Scandinaves constituaient alors une vraie menace. Maintenant pousser plus loin que l'Elbe était peu être trop ambitieux.
Le texte fait référence à l'invasion de la Germanie aussi bien à l'est du Rhin qu'au nord du Danube. Il ne semble pas qu'Auguste ait décidé de pousser jusqu'à l'Elbe et de rester assis sur le Danube. L'idée était plutôt de réduire le saillant Rhin-Danube par des tenailles: offensives conjointes à partir des deux fleuves. |
Citation:
|
Citation:
|
Citation:
|
Cette plèbe, c'est jamais que des civils. Ils peuvent pas battre une armée, si l'empereur ne s'établit pas à Rome.
|
Citation:
Rien n'aurait pu remplacer Rome. C'est une éventualité anachronique que seule des hommes de notre époque peuvent imaginer. Jamais un romain n'aurait pu penser une seule seconde ça (sauf éventuellement le jeune Marcus lorsqu'il racontait ses rêves de grandeur à Marcillia pour la séduire lol). Les distributions gratuites de pain c'était pas du socialisme avant l'heure. Cela répondait à d'autres notions qui nous échappent aujourd'hui comme par exemple l'évergétisme impérial et à des notions qui ne nous ont pas quitté comme par exemple : se rallier les masses. Donc on ne pouvait le supprimer comme ça par simple volonté (même auréolé de la plus grande gloire militaire). |
Citation:
Antoine lui voulait recentrer l'Empire Romain à l'est une fois Octave vaincu. Constantin lui l'a fait. Je pense pas que ça soit si farfelu que celà. Maintenant abandonner Rome et ne plus nourrir la plèbe celà implique un coût politique énorme. Sans compter le fait que bien que moins armés et entrainés que l'armée les plébéins étaient néanmoins plus nombreux. Et puis il ne faut pas oublier que c'est grâce à la plèbe que l'Empire à remplacé la République. Sans la plèbe qui soutient le pouvoir de l'Empereur? |
Citation:
|
Je disais cela pour la fin de la République et le Haut Empire seulement vue les références que vous citiez.
Forcément avec les siècles, les mentalités évoluent. Le Romain d'Auguste ne devait certainement pas avoir la même image de la puissance de l'Empire et de la place de Rome que celui sous Théodose. |
Citation:
|
Citation:
|
Citation:
Ce qui était impensable sous un sénat romain tout puissant ne l'est plus sous le second triumvirat. Plus l'Empire s'étend plus les alternatives à Rome se multiplient. Le Sénat hors de Rome ce n'est plus le Sénat. L'Empereur hors de Rome est toujours Empereur. |
Oui mais les empereurs (je parle toujours au haut empire) ne pouvaient pas se permettre de "désacraliser" Rome en fondant une nouvelle capitale. Bien sur il pouvait vivre en dehors de Rome, Hadrien en est un très bonne exemple mais Rome resté Rome.
Et comme tu le dis toi même pour Antoine, le peuple était outré, révolté, devant ces projets. Or c'est justement ce que j'ai dit. Aucun Romain n'aurait accepté ça au haut empire. Bien sur que l'empereur n'avait pas besoin d'être à Rome pour être empereur, mais Rome était irremplaçable. |
Tant que les armées romaines étaient composées de citoyens, elles ne se sont pas retournées contre la République.
La République était un régime efficace et bien géré qui a réalisé l'essentiel des conquêtes romaines, les plus difficiles. Pendant près de 500 ans la République a gagné toutes ses guerres, a surmonté les pires désastres, n'a fait que s'étendre. Quel régime formidable. Pourquoi elle est morte déjà? Parceque ses armées n'étaient plus composées de citoyens. Si la citoyenneté romaine avait été accordée à tous les soldats de la République, celle-ci ne serait pas tombée. La République me parait un régime plus efficace que le despotisme pour gérer l'empire. Un empereur a une faible légitimité. Le premier général venu peut le renverser s'il est populaire auprès de ses troupes. Ainsi l'empereur de Constantinople se méfiait de Bélisaire du fait des succès de celui-ci. On lui a retiré le commandement de ses armées pour le punir d'être trop compétent. Par contre des soldats ne se retournent pas contre une république dont ils sont les citoyens. La République peut confier d'importantes armées de citoyens à un général sans craindre de révolte de celles-ci. Donc pour que la République romaine ne sombre pas dans la guerre civile et les luttes internes, il suffit de donner la citoyenneté à tous les soldats qui la servent. Si en plus la citoyenneté est liée au service militaire, on favorise le recrutement. Seuls ceux qui effectuent le service militaire ont le droit de vote. Si le service militaire est obligatoire, le coût de l'armée diminue et ses effectifs augmentent. Le régime idéal pour Rome est donc une république où la citoyenneté est liée au service militaire. Que ce service soit obligatoire ou pas. Avec plus de cinquante millions d'habitants l'empire romain avait largement les ressources humaines pour repousser les quelques centaines de milliers de barbares des grandes invasions. Il lui aurait suffit de mobiliser de 1 à 5% de sa population dans l'armée. |
C'est bien beau tout ça mais la République romaine s'est effondrée, et ce sans pression extérieure, mais intérieure ! Le modèle républicain romain n'était pas viable, c'était une grande farce de toute manière, le pouvoir restait dans un cercle d'oligarques pas très soucieux du bien-être de la plèbe !
La citoyenneté était déjà donnée à la fin du service en partie, et au fils du vétéran en totalité. L'image de la formidable république moralement parfaite et à envier sous tous aspects, elle s'est formée plus tard, et les historiens de l'Antiquité ne sont pas vraiment des maîtres d'objectivité :?: |
Curieusement l'armée romaine est aussi nombreuse à l'époque ou elle ne domine que la péninsule italienne qu'à l'apogée de l'empire: 300 000 hommes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_romaine Louis XIV avait également une armée de métier de 300 000 hommes pour un pays de 20 millions d'habitants. Bref, je trouve pas l'armée romaine hyper nombreuse par rapport à la population de l'empire. |
D'un côté,vaut mieux, sinon chaque préteur commencerait à se dire qu'avec ses 4 légions qui lui sont fidèles jusqu'au bout il pourrait 1. proclamer son indépendance 2. tenter de marcher sur Rome avec quelques potes 3. un peu plus piller sa province pour remplir ses poches et celles de ses légionnaires :lol:
Après quand les barbares sont aux portes c'est sur ça aide moins :loose: |
Citation:
Oui non attention, il s'agit bien d'hommes mobilisables quand Rome ne dominait que la péninsule. Et forcément avec une armée de citoyen on peut avoir carrément plus de soldats. Sous la République avant la réforme de Marius, Rome ne disposait régulièrement que de 4 légions, et en mobilisait plus qu'en cas de guerre (seconde guerre punique notamment). Le nombre de légions n'a explosé qu'après la réforme et surtout sous le second triumvirat avant qu'Auguste ne limite le nombre de soldats et les place aux frontières. Donc 300.000 hommes mobilisables au IIIème siècle avant JC, mais 300.000 hommes mobilisés sous l'Empire. |
Citation:
Reste à savoir si ces conscrits étaient aussi efficaces que des soldats de métier. Il faut cinq ans je crois pour former un légionnaire. |
Citation:
Pas aussi efficaces, c'est logique. D'autant plus qu'avant la réforme les soldats étaient mobilisés par tirage au sort (il y avait bien une poignée de volontaires mais bon...), autant dire qu'à chaque fois l'on a des soldats neufs, sauf bien sûr en cas de guerre où l'on ne va pas démobiliser les soldats tous les ans (en temps normal le service militaire commencait au printemps pour finir en automne). Donc forcément, avoir des soldats de métiers pendant une vingtaine d'année au lieu d'avoir des néophytes au début d'un conflit, ça aide. A cela il faut ajouter que le citoyen-soldat devait fournir lui-même son équipement... donc pas toujours toujours de la meilleure qualité selon la richesse (même si les plus pauvres étaient exempts du service... tout simplement parce qu'ils ne pouvaient payer l'équipement). L'harmonisation de l'équipement fourni désormais par le chef militaire aide à augmenter l'efficacité des soldats. |
Sans parler qu'a partir d'une certaine taille, la conscription a des conséquences catastrophiques. Le paysan recruté, s'il reste trop longtemps en campagne, va être ruiné. C'est de plus en plus le cas dans le Ier siècle avant J.-C., et les aristocrates ne se gênent pas pour acheter les terrains des fermiers ruinés pour une bouchée de pain et en tirer un gros profit ! Le parti populaire n'aurait jamais pu voir sa force grandir si la grogne de la plèbe n'était pas aussi énorme (ouais parce que c'est pas une guerre un peu inutile comme la campagne en Grèce après la 2e guerre punique qui les ferait broncher)
|
Citation:
Il y avait bien une soldes pour les soldats à partir du IVème siècle avant JC, par contre je ne sais pas si leur montant était risible ou non :confus: |
Ben ça m'étonnerait qu'elle remplace la valeur des récoltes d'une année sur leur ferme !
Et puis si ça avait été le cas les riches aristocrates n'auraient pas pu aussi facilement racheter toutes ces terres. |
Faut dire aussi qu'Hannibal ayant ruiné la campagne italienne et provoqué un exode rural c'était plus facile de racheter les terres. Et puis ce qui compte avant tout à la guerre c'est le butin plus que la solde. Alors aller piller le voisin juste avant la récolte ok mais faire garnison en Galice c'est déjà beaucoup moins rentable.
Sinon concernant la République si elle est tombée c'est bien qu'il y avait un problème: elle n'était plus populaire. 1789 à l'envers. L'aristocratie (ou du moins l'ancienne) est pour la République et le peuple est pour l'autocratie. |
Citation:
Mais bon octave est devenu auguste et empereur , bel ironie de l'histoire vu comment Octave a reussi à faire passer antoine pour un romain prêt à trahir et se tailler un royaume dans l'empire romain |
Un débat que j'avais manqué... :loose: (quelle idée de partir en vacances aussi :enerve: ).
D'abord, deux remarques : - l'armée romaine était constituée de deux types de troupes : les légions, recrutées parmi les citoyens romains et les auxliliaires, non citoyens romains (mais qui le devenaient souvent à la fin de leur engagement). Les fameuses réformes de Marius avaient permis de recruter les soldats parmi les citoyens qui n'avaient pas le cens, donc les moyens financiers, d'être recrutés comme légionnaires (donc c'était des gens non propriétaires, qui devenaient de facto des soldats professionnels), mais c'étaient quand même des citoyens. Quand les soldats de la dixième légion se révoltent, César les interpellent en les appelant "Quirites", ce qui signifient "citoyens civils", pour bien leur montrer qu'ils ne les considèrent plus comme des soldats, mais ce qui veut bien dire qu'avant d'être soldats, ils étaient citoyens. Donc les armées étaient constituées en grande partie de citoyens, et même après l'implantation du principat. - nous parlons d'empire pour désigner la période qui débute avec le principat d'Auguste, mais il s'agit d'une notion moderne. L'empire romain existait avant le principat, sous la "république" (en fait une oligarchie) et la république se poursuit sous le principat. En effet, Auguste a changé la nature du pouvoir et non les formes : il cumule une grande partie des pouvoirs, mais ce sont des pouvoirs qui existaient déjà sous la "république". D'autre part, il laisse certaines attributions au Sénat (dont il est par ailleurs le "prince" ). Et c'est une des grandes questions (faiblesses ?) de l'"empire" : il n' y a aucune régle de succession, pas de dynastie légitime - tout homme assez puissant pour s'emparer du pouvoir est le prince légitime... jusqu'à ce qu'un autre plus fort prenne sa place. (Ceux qui sont intéressés par la nature du pouvoir "impérial" peuvent lire le début du livre de Paul VEYNE "L'empire gréco-romain" dont j'ai du parler ailleurs sur le forum - pour paraphraser Coelio "Les gens ne lisent pas assez mes vieux posts" :chicos: ). Evidemment, tout cela va évoluer avec le temps. Quant à la question des frontières "idéales" de l'empire romain, il n'y a pas vraiment de réponse. Bien sûr, le territoire romain aurait pu englober la Germanie, la Mésopotamie, etc... mais il aurait alors été au contact d'autres populations potentiellement dangereuses... En fait, c'était un monstre et je trouve miraculeux qu'il ait pu durer aussi longtemps. Le grand facteur unitaire, du point du vue économique et géographique, était la Méditerranée qui permettait des communications relativement rapides et faciles entre les contrées limitrophes, et ce n'est pas un hasard si il s'est constitué d'abord sur ses rives, et l'empire s'est mainenu - sous sa forme byzantine, dans des régions méditérranéennes. Mais même ainsi, il était presque ingouvernable, ce qui a abouti aux réformes de Dioclétiens (la tétrarchie) puis à sa séparation en deux entités distinctes. D'autre part, les historiens modernes pensent que la population de l'empire a diminué environ de moitié entre l'apogée (I-IIème siècle ap. J. C.) et le Vème siècle, les textes nous montrant en effet des régions entières complètement dépeuplées, les "invasions" barbares étant tout autant une immigration pour occuper ces espaces que des expéditions militaires (les barbares ne visant nullement à détruire l'empire, mais voulant bénéficier de sa prospérité supposée). D'où une terrible crise économique (et également monétaire) qui rendait de plus en plus difficile l'entretien des structures étatiques, et surtout des armées. D'ailleurs, les armées "romaines" à la fin de l'empire étaient essentiellement constituées de barbares, tant du fait de la dépopulation de l'empire que de la désaffection totale des "romains" pour le métier militaire. Je dirais donc qu'il n'y avait pas de fontières "idéales", car l'empire romain a disparu essentiellement pour des causes internes, indépendantes de la question des frontières. |
| Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h47. |
Powered by vBulletin® Version 3.7.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Version française #19 par l'association vBulletin francophone